Une approche différente du genre postapocalyptique…
Ce Station Eleven d’Emily St. John Mandel est une approche très particulière du postapocalyptique, sous-genre de la science-fiction qui se caractérise essentiellement par une zombification massive et/ou un survivalisme exacerbé. Le prix Arthur C. Clarke a récompensé en 2015 cet ouvrage qui nous raconte ce que doit être l’humanité quand un grand malheur fauche la civilisation. Survivre, pour n’être guère plus que des animaux ne doit pas être une fin en soi. Si vous avez déjà pratiqué le genre, vous avez vu des personnages émus de retrouver des objets d’avant le cataclysme et particulièrement s’il s’agit de livres ou de supports musicaux. C’est bien le propos ici. L’humanité renaissante ne peut être qualifiée d’humaine que si elle possède ce petit supplément qu’est la culture. La quatrième de couverture nous présente cet ouvrage ainsi :
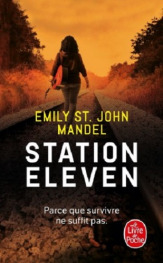
« En l’espace de deux semaines, une grippe foudroyante aux graves symptômes respiratoires a causé l’effondrement de la civilisation. Vingt ans plus tard, parmi les rescapés, une troupe d’acteurs et de musiciens parcourt la région du Lac Michigan et tente de préserver l’espoir en jouant du Shakespeare.
Ceux qui ont connu l’ancien monde l’évoquent avec nostalgie, tandis que la nouvelle génération peine à se le représenter.
Sur plusieurs décennies, entre le passé et le présent, les destinées des personnages s’entrelacent. Si la vie semble encore possible, l’obscurantisme guette, menaçant les rêves et l’avenir des survivants. »
… avec un démarrage de page-turner…
Nous commençons par suivre Jeevan, qui a quelques notions médicales, mais n’a guère les moyens de poursuivre des études en médecine. Pour autant, il a des relations dans ce milieu. Et c’est par ces dernières qu’il apprend l’existence de ce mal venu de Russie qui s’appelle la Grippe de Géorgie. Implacable, cette maladie tue très vite les individus à son contact. Ce début de roman le transforme rapidement en page-turner. C’est typique d’une course poursuite contre un mal inconnu, mais cela laisse à craindre un ralentissement brusque quand le lecteur sera dans la phase exprimant la vie des survivants. Ce changement de rythme ne sera-t-il alors pas un handicap ?
… qui laisse place à un futur peu enviable…
Vingt ans plus tard, le calendrier a changé et c’est depuis la pandémie que les années se comptent. Des survivants de la troupe de théâtre et ceux d’une fanfare militaire ont fusionnés dans un groupe. Certes, il y a des tensions comme dans toute communauté, mais tous forment la Symphonie Itinérante. Certains les ont rejoints, et d’autres ont choisi de s’établir dans une des petites villes sur leur tournée. C’est lorsqu’ils arrivent dans une de ces villes qu’ils découvrent que des amis ne sont plus là. Plus là, depuis qu’un homme qu’on qualifie de prophète est arrivé.
… avec des aller-retours constants entre passé et futur…
Les personnages ont des prénoms pour l’essentiel, mais nombre d’entre eux sont qualifié par leur rôle dans la troupe ou par l’emplacement de leur instrument dans l’orchestre. Il n’est pas ici question de nier leur identité, mais de mettre en avant la fonction qu’ils occupent au sein de ce groupe de survivants, l’état civil étant le cadet de leurs préoccupations. Les allers-retours avec le passé, nous amène notamment à retrouver quelques années plus tôt un personnage qui ouvre ce récit et, si cette phase narrative explique le titre du livre, nous assistons à la vie ordinaire telle que nous la connaissons et sa transformation au travers de la catastrophe.
…mais il faut surtout retenir des parallèles et des clins d’œil brillants
En conclusion, Station Eleven reste une belle introduction pour la Canadienne Emily St. John Mandel. En effet, certains personnages s’interrogent sur l’utilité de leur mission culturelle face à un monde hostile. Un parallèle méconnu est fait avec l’œuvre de Shakespeare, car on apprend que Le songe d’une nuit d’été a été joué après deux ans de fermeture des théâtres suite à la peste qui sévit à Londres. Il est aussi amusant de penser que c’est une phrase d’un épisode de Star Trek Voyager qui sert de sous-titre et de moteur à ce récit : « parce que survivre ne suffit pas ». De beaux clins d’œil et une histoire que l’on n’est pas près d’oublier.
