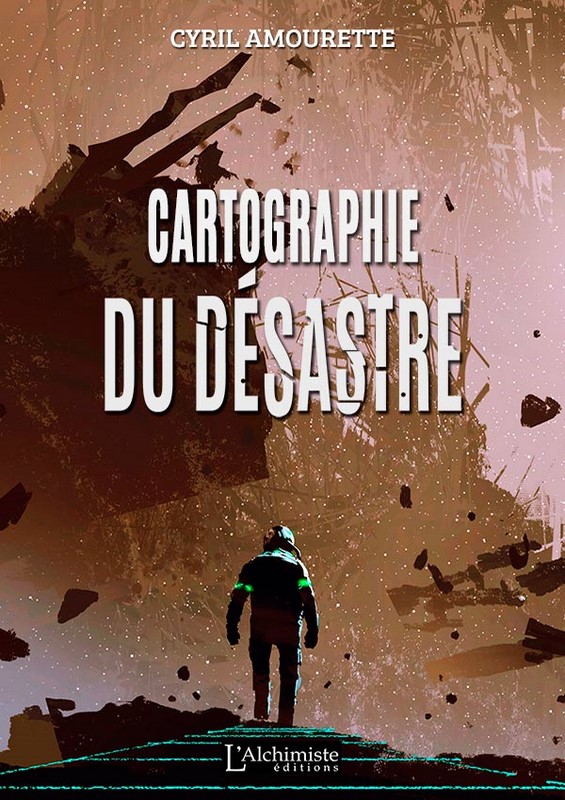Cyril Amourette est un auteur de science-fiction français, auteur de La Cartographie du désastre, que Alaric a adoré. Il a donc décidé de lui poser quelques questions afin de mieux comprendre son oeuvre, ses influences… Une interview sous le sceau de la science-fiction comme on l’aime !
Thomas Riquet
L’influence de Ballard est évidente et presque omniprésente dans le recueil, depuis le titre qui n’est pas sans rappeler celui d’une édition française de ses nouvelles, La région du désastre, jusqu’aux références ici et là (« Nous étions tous des Rêveurs Illimités “). On sent à travers vos textes pointer d’autres grands noms du genre, Philip K. Dick, Ray Bradbury, et dans Sainte-Maggie des Acides, vous en mentionnez quelques autres, comme Priest ou Moorcock. D’autres auteurs, du genre ou hors genre, vous ont-ils suffisamment marqué pour que vous distinguiez leur empreinte dans vos textes ?
Beaucoup d’écrivains ont laissé des traces dans mon travail. Des séquelles.
Étonnamment, Dick et Bradbury, figures tutélaires pour la science-fiction, ne m’ont pas marqué tant que cela. J’avoue même que plusieurs de leurs ouvrages me sont tombés des mains. Dick est un grand nouvelliste, je pense, mais j’ai un problème avec ses romans. Cela doit venir de moi.
Greg Egan a, à mon avis, aussi des difficultés lorsqu’il passe de la nouvelle au roman. Même s’il s’améliore. Mais ces nouvelles m’ont époustouflé. J’aime cette écriture quasi clinique, sans affect.
Conrad et Kipling pour leur exploration de la psyché humaine face à un nouveau monde, le monde moderne embryonnaire.
Lovecraft. Par-delà les tentacules et l’horreur cosmique, c’est l’écrivain de la folie, de la contamination, de la perte du réel. De plus, Lovecraft est un écrivain très moderne : il a sorti l’horreur, et d’une certaine manière la science-fiction, ou la fantastique-scientifique, du gothique. Son époque, l’entre-deux-guerres, était un monde en mutation. L’ancien monde, aristocratique, puritain était en train de mourir et déjà la société industrielle, mécanisée et consumériste était là. Imaginons un instant ce qu’il écrirait, de nos jours, sur les centres commerciaux, les lotissements suburbains, les quartiers d’affaires des grandes villes, les vallées désindustrialisées. L’horreur cosmique du banal.
Dernièrement, c’est Borgès qui me hante et par extension Jacques Abeille. La précision, la densité de ses écrits sont incroyables. Lui aussi habite un territoire de fiction, les Contrées, dont il ne sort que rarement. C’est exceptionnel chez un écrivain, une telle rigueur, une telle volonté de bâtir un monde aussi cohérent, autant intérieurement qu’extérieurement. Et sa langue est d’une beauté et d’une richesse, presque surnaturelle.
Il y a chez Ballard une obsession du lieu, du topos, à la fois comme environnement récurrent (par exemple les pas de tir désaffectés) et comme îlot d’une déréliction à laquelle fait écho la dérive intérieure des personnages. Cette dérive parallèle, intérieure, on la retrouve surtout dans Bienvenue au centre commercial et dans La Nuit où le sommeil s’en est allé, mais elle apparaît moins systématique chez vous que chez Ballard. Une manière de conjurer ce désastre que l’on devine partout, ou un optimisme chevillé au corps ?
Peut-être un mélange des deux. L’un n’allant pas sans l’autre. J’ai tendance à être un pessimiste joyeux, à me réjouir de la catastrophe, à admirer des ruines de supérettes, les entrepôts vides, les parcs de jeux abandonnés. Je suis un grand romantique au fond.
L’influence de Ballard étant déjà très grande dans mon travail, j’ai dû faire quelques coupes pour ne pas être accusé de plagier ouvertement l’Oracle de Shepperton ! Plus sérieusement, j’ai encore du mal à atteindre une telle maîtrise de l’intrication espace intérieur/monde extérieur, comme Ballard, dans mes récits. Mais j’y travaille.
Le lieu est évidemment central en littérature, en fiction, en anticipation. Souvent, je pars de l’image mentale d’un lieu, d’un espace pour construire une histoire, une psychologie.
Dans l’édition précédente de Cartographie du Désastre, que j’avais autopubliée, il y avait une section nommée « Cartographie de l’Hyperzone », c’était une sorte d’atlas, un guide psychogéographique de lieux à venir. Guanghzou, Basel, Rio, Ceylan. En accord avec les éditions L’Alchimiste pour un souci de cohérence nous l’avons supprimé de cette édition. Il s’agissait de description objective, axiomatique, de ces lieux de la catastrophe à venir. Un centre commercial de 300 km de large, une zone suburbaine illimitée sans histoire ni géographie, une île dévolue à l’euthanasie. Il n’y avait pas de point de vue, pas de personnage, juste des lieux, des espaces narratifs. C’était ça l’histoire, le lieu, le topo. J’ai en projet de finir cette exploration, cet atlas monstrueux dans un avenir proche, avant que tout cela n’arrive, réellement.
J’aime beaucoup votre notion de « dérive intérieure », je pense que c’est exactement ça. Au-delà des éléments extérieurs, la catastrophe est le plus souvent intérieure, intériorisée, parfois même plus chaotique, ou porteuse de renouveau. La psyché humaine est sans limite.
La théorie des catastrophes prédit un point de rupture qui fait irréversiblement basculer les systèmes vers un bassin d’entropie. Mais ce point de rupture, cet élément, ce seuil ne sont pas forcément criants, ni sensibles, ni même visibles. L’auteur d’anticipation est là pour les déceler. Pensez-vous qu’il existera, ou qu’il existe déjà un tel point de bascule – à moins que la catastrophe ne résulte d’une série de microévènements composant un continuum lui aussi invisible – et qu’il sera technologique, mental, autre ?
La catastrophe a déjà eu lieu, puis on a éteint la TV et on est retourné travailler le lendemain. Regardons la consommation massive de tranquillisants, antipsychotiques, d’alcools, de drogues diverses et variées, de pornographie, de violence, de nicotine, de caféine de l’humanité. Croyons-nous sérieusement que cela se passe bien ?
Tous les systèmes tendent vers l’entropie, que ce soit sur le temps long, les millénaires, les civilisations, ou sur le temps court, une journée, une vie. La catastrophe est inévitable. Il ne s’agit plus de dire « si », mais « quand ». Chaque personnage a une réponse à apporter, et c’est cela qui m’intéresse. La catastrophe, en soi, n’est que facultative.
Ce que suggère votre « cartographie » avec ses variantes, c’est qu’il existe un nombre infini de ruptures douces, lentes, susceptibles de faire partir le monde à la dérive, voire le faire sombrer. La littérature de genre est riche en fins du monde, et, tout particulièrement avec Ballard, les effondrements ralentis ont commencé à l’emporter sur les apocalypses brutales. On n’en a jamais vraiment fini avec ces fins du monde insidieuses : le lecteur en vient à supposer que vous en méditez d’autres : à tort ou à raison ?
J’ai un côté pervers, une petite voix qui souvent, à la lecture d’une info ou au visionnage d’un reportage, me dit « et si… ». Le réel a pris le pas sur la fiction. Regardez les titres des bandeaux en bas de l’écran des chaînes d’info en continu, ou bien les titres racoleurs – les putaclics –, des sites d’infodivertissement du net. Les people enceintes y croisent la guerre en Syrie, le terrorisme intérieur est un jeu TV, les animateurs sont des nouveaux leaders d’opinion ; un avion se crashe, les soldes sont lancées, les avancées technologiques ne sont que du marketing dissimulé ; la science est sans cesse conspuée, les politiques ont leur Instagram.
Bienvenue au centre commercial laisse une impression étrange. Derrière le texte, on devine une image, un sportif sur un stade qui a en ligne de mire la barre du saut en hauteur. Il hésite, il piétine un peu, il ne sait pas s’il va le lancer. On sent qu’il se demande s’il a une chance de réussir à passer. On vous voit, littéralement, hésiter à écrire un roman. Vous avez eu ce type d’hésitation, vous avez choisi de faire un galop d’essai avant de passer à un format plus long ?
Cette nouvelle est l’une des premières que j’ai écrites, alors oui, elle est maladroite, elle hésite, elle piétine, elle tâtonne. J’apprends mon métier et c’est compliqué, long et il n’y a pas de manuel. Il faut essayer, sans cesse, recommencer, échouer, échouer, échouer.
J’ai écrit la suite, l’exploration du centre commercial Parly-2 par le narrateur. Ce n’était pas bon, je n’ai pas réussi à exprimer ce que je voulais. Peut-être vais-je y revenir plus tard.
On trouve sur votre site une illustration du peintre Jean-Pierre Ugarte, qui met souvent en scène des lieux déshabités, oubliés peut-être. Des ruines, des mondes que l’on devine finissants, abandonnés. Notre pays lui-même, dès que l’on s’éloigne des grands axes, montre un clivage très net, et qui sans doute ne fait que s’accentuer : plus rien à voir avec des zones d’hyperactivité et de construction perpétuelle, mais des environnements en proie à une métamorphose inverse, des segments de nationales oubliés, déjà recouverts par la végétation, des zones industrielles laissées en friche, des sites, des villages, des bourgs à l’agonie. Déjà, un monde déshabité, des ambiances crépusculaires et de fin du monde. Cette fin du monde aurait-elle selon vous déjà commencé, serait-elle apparue de manière occulte, discontinue, par flaques, par segments topographiques ? Et, question corollaire, partagez-vous ce goût des lieux déshabités, cet « urbex » au sens large qui est en train de devenir un art à part entière ?
La France Abandonnée ! Évidemment ! Les trente glorieuses sont en train de s’écrouler sur elles-mêmes, elles disparaissent avec la génération du baby-boom ; cette France se meurt, littéralement. C’est un formidable terrain d’anticipation, et je ne comprends pas pourquoi il n’y a pas plus d’auteurs français qui ne s’en emparent. Ce mélange de bourgs déserts, hantés par une jeunesse rurale à la dérive, ces lotissements-dortoirs, réceptacles de récits grotesques et banals, ces rocades sans fin, ces centres commerciaux à l’entrée de chaque ville. Certains l’appellent la France Moche, ou la France d’en bas, mais c’est la France du XXIe siècle ! Et même une partie de l’Europe.
L’urbex est symptomatique de notre civilisation : à l’hypernouveauté, à la dynamique accélératrice des changements, on chérit, on glorifie les ruines d’un passé récent. La fascination des ruines d’une modernité morte, pour une grande part de la jeunesse, est un symptôme que quelque chose ne va pas avec cette hypermodernité. Peut-être une absence d’âme, de vie.
Dans Le Jour où Ballard est mort, vous écrivez que la génération suivante écrira plus de livres qu’à n’importe quelle époque de l’humanité, mais que « l’homme fera moins de rêves qu’avant les premiers pas de l’homme sur la lune. » Quelque chose serait donc définitivement mort, nous entrerions dans une ère post-idéalisme, post-aspirations, ou même post onirique ?
Je voulais mettre en avant les utopies, les idéaux de la génération de Ballard, au regard de la nôtre. « On voulait des voitures volantes et on a eu 140 caractères », a dit Peter Thiel, le gourou libertarien de la Silicon Valley. Le futur est mort, Ballard l’avait déjà prédit, il n’y a rien de nouveau à cela et d’autres l’ont dit avant lui. Il y a cette prescience des artistes à voir le monde et leur art changer. Mais je ne me résigne pas, la guerre que le réel fait contre l’imagination, l’onirisme n’est pas perdue. Il y a encore des batailles à mener. Le monde change.
Dans le même texte, vous parlez également des « assauts répétés de cette même guerre contre l’imaginaire et le rêve », et de « l’échec de notre imagination ». L’imaginaire serait-il à réamorcer, à réinventer, faudrait-il, de toutes pièces, forger un imaginaire entièrement nouveau ?
Combien de romans d’anticipation prennent vraiment notre monde pour cadre ? Ballard et d’autres le disaient déjà à l’époque, le disent encore maintenant. On écrit sur des colonies interstellaires, ou des contrées lointaines recouvertes de forêts ensorcelées, mais rien, ou si peu, sur nos cités dortoirs, nos sous-préfectures, nos pavillons de banlieue. Il n’est même pas nécessaire d’en forger un entièrement nouveau, il est là, devant nos yeux, cet imaginaire, à nous d’en assembler les pièces qui, au premier abord, peuvent nous sembler disparates ou incongrues. J’aime beaucoup l’expression que Ballard utilisait à ce sujet : « il faut réinventer la réalité ». Je trouve que cela résume bien mon travail.
La chronique de « Cartographie du désastre » :http://www.emaginarock.fr/cartographie-du-desastre-cyril-amourette/